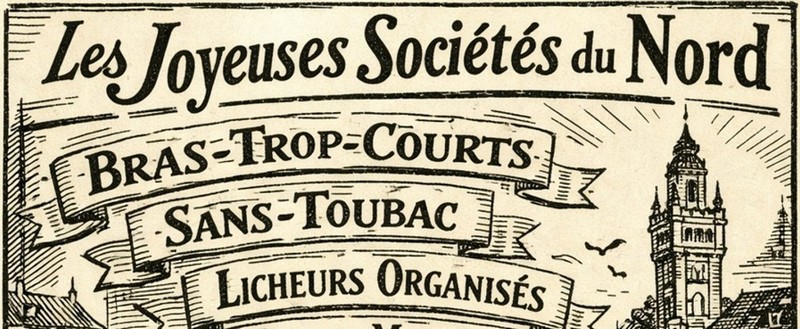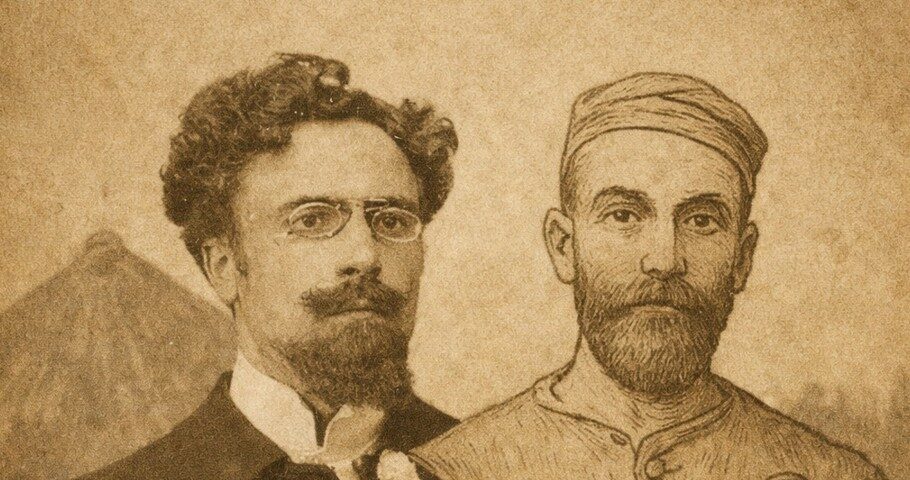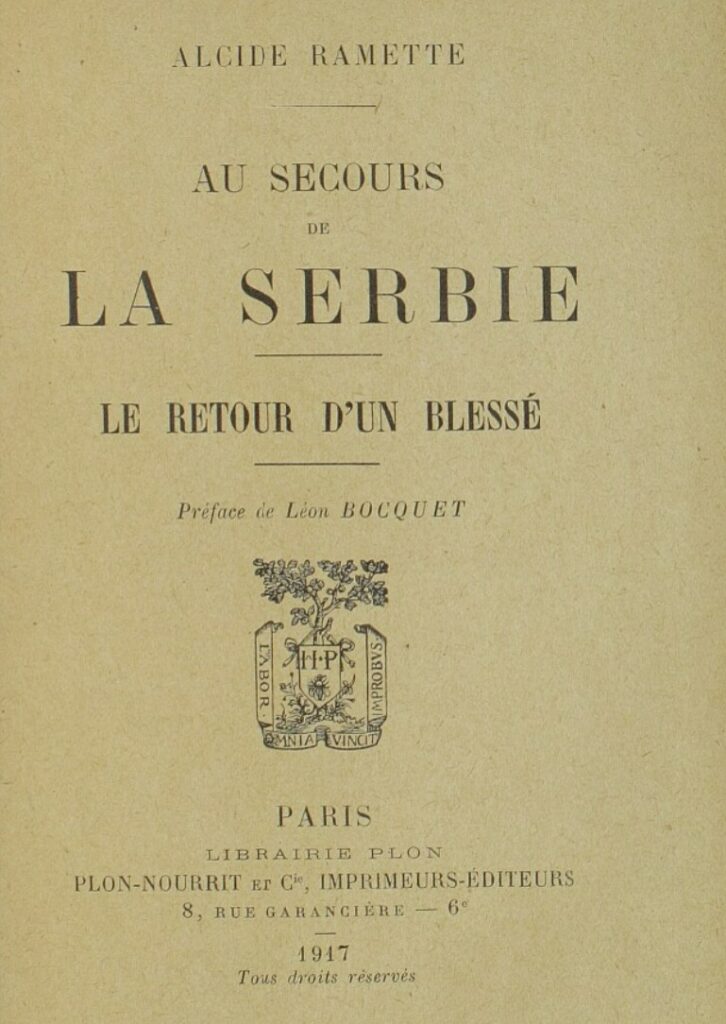
Sauf dans ses grandes lignes, on ignore encore presque tout de l’expédition française en Balkanie. L’histoire ne s’en trouve que médiocrement ébauchée dans les phrases concises et réticentes des communiqués officiels. Les bulletins, pas même quotidiens ni hebdomadaires, secs comme des résumés de chapitres qui restent à écrire, sont insuffisants à satisfaire les curiosités intriguées par le développement du drame immense dont les principales scènes se jouent, en même temps, de la mer du Nord à la mer Égée.
Voici un livre qui apporte entre ses pages, sur une question de passionnante actualité, cette denrée précieuse et rarissime : de l’inédit.
Entendons-nous. Il ne nous révèle pas la Macédoine. Ce nom est déjà fort ancien aux annales du monde. Ni la Serbie. Avant les malheurs d’aujourd’hui, cette nation a connu d’autres heures tragiques et surmonté d’autres épreuves. Macédoine et Serbie, au surplus, sont des régions assez explorées depuis qu’il y a des hommes, et qui voyagent, des géographes et des touristes, pour n’offrir que peu de nouveauté aux amateurs d’exotisme. Mais une Macédoine transformée en vaste camp retranché franco-anglais, une Serbie devenue, par l’indifférence ou la trahison de ses alliés d’hier, la proie facile des empires centraux, le champ de bataille où se brassent les destinées de l’Europe future, ce sont là événements d’importance et qui modifient d’imprévu l’aspect caractéristique et comme la tonalité de ces pays. Dans l’atmosphère que crée la guerre, s’accusent et prennent du relief des particularités et des détails qui risquaient auparavant de passer inaperçus. Le décor, vu en pleine épopée, se transforme. La psychologie ethnique se fait de même plus complexe et plus insaisissable et les réflexions qui s’imposent à l’observateur atteignent une portée plus générale où acquièrent une signification autrement élevée. L’attrait immédiat des choses étrangères s’augmente de pathétique puissant, à considérer que pour l’indépendance ou le salut de ces contrées où s’affrontent les adversaires, pour la défense de ces paysages d’Orient et de ces races martyrisées, des hommes viennent de l’Occident, souffrent, tombent et meurent.
Au secours de la Serbie juxtapose deux récits qui paraissent, dès l’abord, n’avoir entre eux que la seule affinité d’être des épisodes de cette lointaine entreprise. Lien fragile en vérité, que celui-là, pour constituer l’unité du volume aussi bien que cette ressemblance fortuite qui distribue les deux parties sur un nombre de feuillets sensiblement égal.
A y regarder de plus près, il y a mieux. D’abord l’unité chronologique joint et soude, l’un à l’autre, les récits comme les temps successifs d’une même action.
Là, c’est le départ vers l’Orient, les péripéties de la traversée, le débarquement à Salonique, la vie nomade du camp, les combats le long du Vardar et l’aventure guerrière poussée jusqu’à Krivolak. Puis, dans l’impossibilité d’apporter aux Serbes écrasés une aide efficace, le méthodique et admirable repli des troupes jusqu’à leur base d’opération.
Ici, plus circonstancié, puisque les faits sont groupés autour d’un individu et non plus collectifs, la marche inverse. Un éclopé d’une reconnaissance audacieuse vers les lignes bulgares, au moment du recul volontaire, est ramené des positions avancées de la montagne jusqu’à Guergueli. De là il est dirigé à Salonique, enfin en France.
C’est le retour d’un blessé. Pour motifs de ces pages : le bateau-hôpital et ses hôtes, la vie immobilisée, l’émotion de l’arrivée, les jours solitaires, si longs, si longs, de la convalescence, l’impatience du repos forcé, l’obsession de l’Orient, où les autres sont demeurés afin de parachever l’œuvre de libération des peuples opprimés.
Dès lors, il est indifférent d’observer que le héros du premier récit est l’adjudant Lefranc, que le héros du second est le lieutenant Robert. Ils se ressemblent comme des frères. Mieux encore, ils se prolongent et se complètent. Ils composent en fin de compte un même personnage. Faut-il affirmer que tous deux sont créés à l’image et à la ressemblance de l’auteur lui-même? J’irai jusque-là. Sous le masque des figures jumelles, un unique visage apparaît. Les gestes et les pensées de Lefranc et de Robert traduisent une âme unique. Un fragment d’autobiographie se précise et se dessine, la part faite aux exigences de l’affabulation. Alcide Ramette y satisfait dans Au secours de la Serbie en composant le portrait de Lefranc par un choix judicieux de touches qui en font un type représentatif de ces hommes du Nord, en qui s’incarnent de mâles vertus : le courage silencieux, la conscience stoïque de l’impérieux devoir et la notion idéale du sacrifice à la Patrie.
Dans Le retour d’un blessé, cette précaution à déguiser l’individualité existe déjà moins, à cause de la forme personnelle employée. Ni transposition, ni substitution, ni artifice. Les faits s’enchainent aux faits, selon la logique, sans qu’aucune méthode ou recherche de composition intervienne. Un officier transcrit quotidiennement, sur son cahier de campagne, ses impressions, voilà tout.
Je veux souligner toutefois que, par un scrupule de métier bien compréhensible et sans doute afin d’accentuer l’étroite relation des tableaux du diptyque qu’il nous présente, l’auteur a voulu, en quelque sorte, préparer le passage du récit romancé au récit simplement historique. Les quelques pages détachées du carnet de Victor Lefranc au dénouement d’Au secours de la Serbie ne sont-elles pas une manière de transition, acheminant au style direct adopté dans Le retour d’un blessé ?
Mieux que par un raccord, aussi adroit soit-il, l’homogénéité du livre s’affirme par le souffle patriotique, ardent et généreux, qui le traverse, l’anime, le vivifie, lui confère une ferveur émouvante. Par-dessus la corrélation des faits, on sent la cohésion profonde des idées et du sentiment.
Car Alcide Ramette est plus qu’un spectateur attentif et sincère qui presse tant qu’il peut la réalité. Il est un acteur et un patient des scènes qu’il raconte. Au souci d’exactitude et au scrupule de vérité du témoin loyal, il ajoute l’authenticité de son exemple personnel. Si j’avais besoin le moins du monde d’être confirmé dans mon assertion, il me suffirait de relire les citations à l’ordre du jour. Celle-ci : « Alcide Ramette, lieutenant commandant la 1re compagnie, officier des plus dévoués, qui, depuis huit mois, se dépense sans compter dans le commandement de sa compagnie dont il a su faire une unité bien en main. S’est particulièrement distingué en dirigeant lui-même, avec beaucoup d’à-propos, deux reconnaissances des positions ennemies. A été blessé au cours de la seconde, alors qu’il venait de réussir à faire six
prisonniers Bulgares. »
Il y a là, en raccourci, le thème de l’embuscade qui ouvre Le retour d’un blessé. Et j’ai sous les yeux, à l’instant que j’écris, une toute petite photographie. Elle représente un jeune officier français en croupe d’un Bulgare. La lettre qui m’apporta naguère cette image m’expliquait, à peu près comme il est dit dans ce livre, l’énigmatique position. Le jeune lieutenant de l’armée d’Orient, je l’avais tout de suite reconnu. Il ne s’appelle pas Robert. Et la lettre n’est pas davantage signée de ce nom.
Bénéfice immédiat et tangible de ces souvenirs familiers. Nous pouvons faire confiance, malgré le voile romanesque dont la réalité s’enveloppe et malgré des incidents en apparence menus et limités, au côté documentaire de l’ouvrage. Il n’y a rien d’insignifiant, dès qu’il s’agit de la vérité. Les détails sont la source infime d’où s’expriment les vues d’ensemble et les lois de l’histoire.
Sans y prétendre, Alcide Ramette fait œuvre d’historien. Il est le chroniqueur oculaire de la campagne de notre armée d’Orient à Kavadar, Cicevo, Rosoman, Stroumitza. Autant d’étapes d’une avance pénible et qui ne fut pas sans gloire. On savait qu’au terme de la progression ardue, il n’y avait qu’une démonstration héroïque accomplie, un beau geste vain. Un peu plus tôt, un peu plus tard, le repli s’imposerait. Et ce fut la fameuse retraite des 20 000,
de Krivolak a Salonique. Retraite mémorable à l’égal d’une victoire par les obstacles surmontés, la prudence et l’habileté de la manœuvre. Qu’il le veuille ou non, Alcide Ramette apparait comme le Xénophon de cette nouvelle Anabase.
Un Xénophon poète d’ailleurs. On s’en aperçoit aisément à l’art de replacer les incidents de l’expédition dans leur âpre décor, au soin d’unir et de fondre, en proportions savamment dosées, les visions et réflexions a la sobre description.
La reconnaissance vers Kara-Eliazki, entre autres, est tout imprégnée de poésie nocturne. Le contraste est frappant entre le rapport officiel de la patrouille dans sa brièveté schématique et sa précision technique et l’ample développement qui le suit. La peinture changeante de la vallée aride où gronde le torrent du Vardar, tandis que les cimes des monts, une à une, se dégagent de l’ouate bleutée du brouillard matinal, compose un tableau délicieux. Ce n’est point le seul. Les notations subtiles et délicates abondent. Ne saurait-on pas qu’avant d’être soldat Alcide Ramette a publié les strophes de Clartés au crépuscule et du Rouet de buis qu’on le devinerait poète d’après sa prose et ses évocations. Et poète du Nord, en outre, c’est-à-dire sans verbiage ni fausse éloquence, plus attaché qu’aucun autre aux jeux de l’ombre et de la lumière, aux nuances imprécises de l’atmosphère, d’une sensibilité très fine et d’une qualité d’émotion particulièrement séduisante.
Le poète, il se découvre à tout coup, aux spectacles qui s’offrent à ses regards et à la vibration intime que suscitent en lui les êtres et les choses. Il vit dans une plénitude d’enthousiasme, de chaleur lyrique et d’exaltation. Dans ces conditions il subit jusqu’à la passion l’emprise et l’éblouissement oriental. Sans doute, le mirage de ces pays les plus beaux du monde et le prestige des noms les plus grands de l’histoire gardent sur les âmes une magnifique puissance de suggestion. Mais la verte Trinacrie, la Sicile de Théocrite et des Boucoliastes, les flots de l’Archipel, les blanches Cyclades égrenant leurs iles comme un collier de perles dénouées, Sparte, Marathon et leurs fastes inoubliables chantent dans la mémoire de l’auteur avec une particulière et frémissante douceur. Le ravissement est presque religieux quand le rêve évoque l’Hellas des dieux païens et des blancs parthénons parmi la lumière heureuse qu’Iphigénie mourante regrettait avant sa jeunesse et que Sapho compare à la molle beauté d’une jacinthe épanouie.
L’âme romantique d’un Shelley, d’un Keats ou d’un Byron habite en lui. Et tout ce qu’il reste d’un peu livresque et de conventionnel, dans l’admiration que suscitent ces souvenirs classiques, cède devant la flamme d’inspiration de ce philhellène obstiné. Lorsque Lefranc succombe à Salonique il est convaincu de mourir pour un aussi noble idéal que s’il avait verse tout son sang en Argonne, en Artois, ou en Flandre, pour défendre la terre de France, son clocher et ses morts.
Il participe dans sa pensée à l’affranchissement de la Serbie flagellée et à la rénovation du peuple grec que l’astuce expectante de son Basileus écarte de l’accomplissement de ses destinées séculaires. Pour être formulés a diverses reprises et définis de façon plus directe, dans le deuxième récit, je persiste à croire que les faits, sous l’apparence de la fiction ou celle du mémorial, ont exactement le même caractère. Les personnages, inventés ou non, ne sont que d’ingénieux prétextes à la manifestation d’une pensée uniforme, d’une direction constante des opinions et sentiments.
Alcide Ramette ne se défend pas, à l’occasion, d’apprécier et de juger en toute liberté. Il faut lui savoir gré de sa franchise. La fougue de son enthousiasme pouvait égarer sa lucidité. Elle n’y a point nui.
L’atmosphère de stoïcisme et de vaillance qu’on respire au long de ces pages, l’accent de sublime abnégation qu’on y entend, le son de métal éprouvé et pur, comme d’un beau bronze sonore, que rendent les âmes de Lefranc, de Robert et, quelques tons plus bas, de ces héroïques anonymes que sont leurs hommes n’a point de faille. Il risquerait même d’être taxé d’exagération idéaliste, s’il n’y avait, en face des exemplaires admirables, le contraste de natures plus terre à terre. Mais, nouvelle preuve en faveur de la sincérité de l’ensemble, l’humanité moins haut grimpée en patriotisme, en dévouement, en perfection morale, l’humanité prudente, égoïste, calculatrice s’y retrouve. Il y a le jeune major bavard qu’un rhumatisme opportun dérobe aux risques d’un départ imminent. Il y a le commissaire de gare, collectionneur, qui évacue de Salonique, où la sécurité parait compromise, une précieuse macédoine d’antiquailles et de bibelots rares dont il escompte en France bon profit. Il y a l’infirmier pour qui les considérations d’ordre supérieur ne tiennent pas devant l’ennui et le péril de vivre loin de ses habitudes et de son champ. A ceux-là ne disent rien paysages ni passé, ni ces nobles entités, qui font vivre et mourir, et le devoir n’impose pas son fier langage. Ceux-là n’ont pas la sympathie de Ramette. Mais il ne s’attarde pas à les mépriser; il constate et passe. Il dédaigne s’arrêter aux spectacles déprimants, non par crainte d’entamer son optimisme, par dignité plutôt.
Des ombres au tableau, il en voit et lui-même en indique.
Ainsi, il ne me déplaît pas qu’il avoue que notre faiblesse dans cette guerre a été de faire au sentiment. Mais il fait cette constatation sans amertume ni arrière-pensée de critique déguisée. Et de conclure que, voudrait-on réagir, ses hommes, comme lui, seront toujours sans courage contre des vaincus ou des prisonniers et sans efficace aux représailles. C’est très beau, cela.
Se montrer magnanime, chevaleresque, pitoyable, même à contre-sens et à notre détriment, n’est-ce point le travers et la grandeur du caractère Français?
Je me souviens en remarquant ceci de la lettre d’un petit paysan du Nord qui, de Gallipoli arrivé à Salonique, m’écrivait : « Autour du camp il y a beaucoup de femmes et d’enfants turcs qui mendient. Ce sont les enfants et les femmes de ceux qui combattent contre nous. On le sait. Mais ils ont faim et font pitié et nous partageons avec eux notre ration. » Celui-là aussi, bellement, faisait du sentiment. Admirable faiblesse !
Et avec ces affirmations, ces dons frémissants, ces ardeurs communicatives, la belle foi ardente, réfléchie, inébranlable, amoureuse, absolue en la France éternelle et en sa mission œcuménique !
Je ne veux pas savoir après cela si, en faveur de tout ce que ce livre représente, quelques façons de dire sont non conformistes, si quelques tournures de phrases ont l’accent provincial du Nord. Choqueront-elles les délicats ? Tant pis ! Les délicats sont malheureux, a dit La Fontaine, qui était aussi un septentrional de bon goût. Pour moi, j’y ai respiré, sans désagrément, comme un parfum de terroir. Et puis c’est ici, avant une œuvre de poète, une œuvre de vrai soldat, pas de littérature d’arrière.
Le front, s’il permet d’enrichir la sensibilité d’impressions inédites, est le dernier endroit où un écrivain ait loisir de s’attarder à ciseler des phrases. On y fourbit des armes au repos. Il sied au contraire qu’il reste, dans les ouvrages conçus là-bas, une certaine rudesse propre à en indiquer l’origine, la même qui caractérise ces bijoux des tranchées sommairement façonnés avec des éclats de mitraille et des instruments de fortune par l’ingéniosité des artisans de la victoire.
Plutôt qu’à une critique, même discrète, de l’œuvre ainsi élaborée entre deux combats, il vaut mieux finir sur un éloge et féliciter l’écrivain qui, si loin du bienfaisant foyer natal, si douloureusement distant de ses affections, dans son double et angoissant exil, a gardé assez de courage et de sérénité d’âme pour proposer la haute et réconfortante leçon de patriotisme que voici. Car il ne s’agit pas seulement d’un appel à la volonté, à l’énergie et à l’espoir. Au secours de la Serbie est une démonstration pertinente de la valeur morale de l’esprit d’abnégation, d’endurance et de sacrifice. C’est surtout un fier acte de foi à l’impérissable vocation civilisatrice de la France.
LÉON BOCQUET.